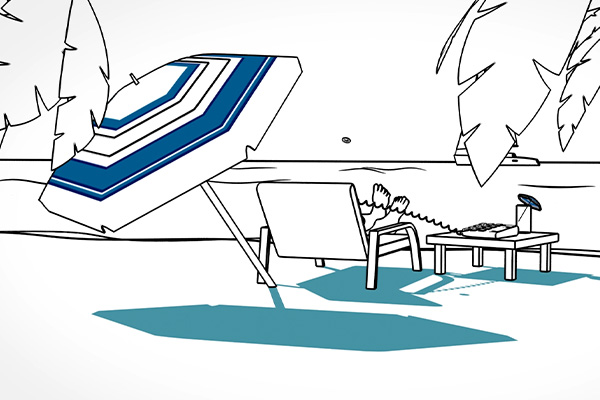L’Allemagne a bouclé sa deuxième année de récession. Pour les Allemands, c’est une catastrophe ; les Français y voient une opportunité, sauf que les Français ont du mal à se donner les moyens d’en sortir… L’année 2024 s’est terminée par une nouvelle baisse de son activité. Le PIB a décru de 0,2 % et c’est la deuxième année consécutive que l’Allemagne est en récession, avec une perspective assez sombre, parce que l’État et les Länder ne trouvent pas la formule magique pour sortir de cet enlisement… d’où les incertitudes politiques qui ont conduit le chancelier à démissionner pour organiser de nouvelles élections où l’extrême droite paraît bien placée.
Après le choc de ce nouveau recul qui n’était pas annoncé en 2023, les indicateurs ne se sont pas redressés l’année dernière. Les principaux moteurs du modèle allemand n’ont pas redémarré.
Les exportations ont encore baissé alors que le commerce mondial a rebondi en 2024. La consommation, de son côté, a continué de piétiner à 0,2 % sur l’année, en dépit du recul très spectaculaire de l’inflation et de la hausse des salaires. Ces boosters d’activité que sont les prix et les salaires n’ont pas activé le modèle industriel du pays.
Sur le plan social, la situation pour les Allemands est catastrophique parce que les leaders de l’industrie automobile mondiale que sont les Allemands préparent des plans sociaux assez massifs. Volkswagen annonce 35.000 suppressions d’emplois, ThyssenKrupp 11.000 emplois en moins… Ce qui désole les dirigeants allemands, c’est que toutes les tentatives de relancer la machine à produire dans des conditions compétitives ont échoué. Le gouvernement fédéral et les Länder ont augmenté leurs dépenses près de 3 % par an, mais ces augmentations de dépenses n’ont provoqué aucun effet, sauf de gonfler l’épargne. Les investissements ont eux aussi été boostés sans résultats. L’offre comme la demande semblent déconnectées de l’activité qui reste freinée, au grand dam des dirigeants familiaux des ETI, qui ont fait jadis la fortune de l’économie allemande.
Bref ni Keynes, ni Schumpeter ne répondent au téléphone. Tout se passe comme si l’Allemagne avait perdu les recettes de la croissance. Il faut dire que la secousse d’ordre structurel a été violente. En très peu de temps, l’Allemagne a perdu deux de ses moteurs qui paraissaient immuablement installés :
- L’Allemagne a perdu l’accès à l’énergie abondante et pas chère livrée par les Russes via les gazoducs de la Baltique et s’est retrouvée sur le sable. Le gaz russe, c’était son pétrole à elle qu’il a fallu remplacer, mais pas au même prix.
- L’Allemagne a perdu son principal marché pour les voitures haut de gamme que les industriels vendaient en Chine. Quand la Chine, au lendemain de la crise Covid, a été sortie de la mondialisation, les classes dirigeantes chinoises ont cessé d’acheter des Mercedes. Et pour l’Allemagne , le haut de gamme allemand, est son arme secrète pour conquérir les marchés étrangers, dont la Chine, mais pas que la Chine.
Aujourd’hui, l’Allemagne n’a donc pas réussi à se trouver une énergie de substitution pour s’affranchir du gaz. Par ailleurs, l’industrie automobile allemande est tombée malade à cause d’un marché chinois compliqué et des exigences écologiques incontrôlables. Alors que la Commission de Bruxelles se montrait toujours plus exigeante pour atteindre des normes de décarbonation suicidaires, parce que trop rapides. Cerise sur le gâteau, les projets de Donald Trump d’installer des droits de douane ont plombé les prévisions des industriels exportateurs et encore plus le moral.
Au début de cette année 2025, l’Allemagne n’a donc pas surmonté les ruptures structurelles et n’a pas réussi à actionner les outils d’une reprise conjoncturelle. Aussi bien du côté de l’offre que du côté de la demande, les moyens libérés pour relancer la consommation ou les investissements sont tombés à plat. Et c’est bien cet échec que paie le chancelier Scholz, obligé de renvoyer les Allemands aux urnes et qui se retrouve face à une menace d’extrême droite et populiste.
Au terme de ces deux années de difficultés, l’Allemagne se retrouve a priori dans une situation plus difficile que la France… Parce que la France bénéficie d’une petite croissance, notamment de sa consommation. La situation de l’emploi se détériore un peu, mais le poids du service public fait que les défaillances sociales sont amorties.
Alors, la comparaison des deux modèles économiques ne se solde pourtant pas à l’avantage de la France. Le modèle allemand est fracturé, certes, mais le modèle allemand a des leviers de reprise en bien meilleur état que la France. D’abord, les grands équilibres sont beaucoup moins menacés qu’en France. Le déficit public allemand s’est élevé tout juste à 2,6 % l’an dernier (versus un déficit français supérieur à 5 %, avec un endettement public limité à 25 % du PIB, alors que la France est au bord du dépôt de bilan avec 120 % d’endettement). Autant dire que la France vit à crédit avec des autorisations qui sont dépassées.
Alors, la sagesse allemande sur la dette publique est évidemment un facteur de confiance durable pour les investisseurs, mais c’est aussi un frein au financement d’un plan de relance dans la mesure où l’Allemagne s’est donné une règle constitutionnelle qui l’oblige à limiter le déficit budgétaire à 0,35 % du PIB. L’Allemagne voudrait-elle se donner de l’oxygène comme la France qu’elle ne pourrait pas, sauf à réviser sa règle. La limitation du déficit est très réglementée, comme aux États-Unis. L’Allemagne ne peut pas vivre à crédit.
Autre levier de reprise, sa balance commerciale est très excédentaire, ce qui prouve que sa compétitivité est très bonne, notamment pour les produits industriels (automobile, machines-outils, équipements sanitaires, électroménager). L’Allemagne souffre sur certains secteurs de l’essoufflement du marché chinois, mais l’Allemagne domine encore très largement le commerce intra-européen.
Enfin, l’Allemagne bénéficie de deux avantages que n’a pas la France.
D’une part, une force syndicale très puissante qui participe à la cogestion du modèle social dans la plupart des entreprises.
D’autre part, l’Allemagne bénéficie, sur le plan politique, d’une culture du compromis qui lui permet de trouver des majorités de gouvernance et d’éviter l’incertitude politique qui, comme en France, détériore l’image du pays face à ses créanciers et évite le spectacle lamentable auquel on assiste depuis la dissolution de juin.